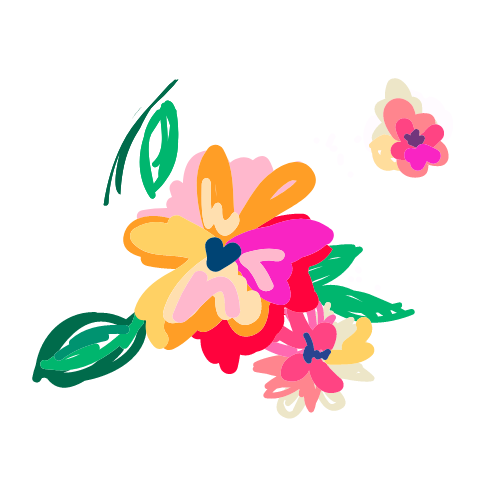Sans que nous en ayons toujours conscience, certaines blessures anciennes imprègnent notre quotidien. Souvent enracinées dans l’enfance — dans ces moments où nous n’avons pas été vus, entendus, aimés ou respectés comme nous en avions besoin — ces blessures peuvent façonner notre façon d’être, nos réactions, nos relations, et notre rapport à nous-même.
À travers cet article, je vous propose des clés pour comprendre comment ces blessures influencent nos comportements d’adultes et comment la thérapie peut vous aider à les surmonter.
Qu’est-ce qu’une blessure émotionnelle ?
Une blessure émotionnelle est une mémoire affective non résolue, liée à une expérience perçue comme douloureuse. Elle peut provenir d’un événement marquant, mais aussi de situations répétitives ou d’un manque affectif.
Il peut s’agir par exemple :
- d’un parent distant ou surchargé, peu disponible émotionnellement,
- d’une parole blessante répétée : « tu es trop sensible », « tu fais toujours tout de travers »,…
- de moqueries, dénigrements répétés,
- d’un manque de reconnaissance ou de valorisation,
- d’un sentiment d’injustice, de rejet ou d’abandon.
Pour se protéger de la douleur, l’enfant apprend à s’adapter. Il développe des stratégies pour moins souffrir, être aimé, tenir debout. Des mécanismes de survie, souvent inconscients, qui l’aident à traverser ce qu’il vit. Utiles à un moment donné, ces stratégies deviennent peu à peu des automatismes… qui finissent par nous enfermer. Jusqu’au jour où nous choisissons d’y mettre de la conscience — et, parfois, de nous faire accompagner pour en sortir.
Les 5 blessures émotionnelles
Cinq grandes blessures émotionnelles sont à l’origine d’une grande partie des souffrances abordées en thérapie.
Elles peuvent prendre des formes différentes selon les personnes, mais elles ont toutes en commun de toucher à ce qu’il y a de plus sensible en nous : notre besoin d’amour, de sécurité, de reconnaissance et de justice.
- Le rejet : se sentir non désiré, ignoré, exclu.
- L’abandon : avoir vécu une absence affective ou physique importante.
- L’humiliation : avoir été rabaissé, dévalorisé ou ridiculisé.
- La trahison : avoir perdu confiance suite à une promesse non tenue ou un mensonge important.
- L’injustice : avoir été traité de manière rigide ou injuste, sans possibilité de s’exprimer.
Ces blessures peuvent coexister, se croiser, se réactiver à différents moments de notre vie. Nous les portons tous, à des degrés divers. Chez certain·es, elles restent discrètes, presque silencieuses ; chez d’autres, elles s’imposent avec plus de force, influençant profondément la manière d’être en lien avec soi-même, avec les autres, et avec le monde.
Comment ces blessures impactent nos vies d’adultes ?

Je vous partage ci-après quelques exemples de comportements qui prennent leur source dans ces blessures émotionnelles.
La blessure de rejet peut pousser à éviter systématiquement les conflits, à taire ses opinions ou à s’effacer dans les relations, par peur de ne plus être aimé·e ou d’être mis·e à l’écart. Il peut y avoir une sensation d’illégitimité, une impression de ne pas avoir de place.
La blessure d’abandon se traduit souvent par une grande insécurité affective : un simple éloignement peut déclencher de l’angoisse, un besoin de réassurance constant, ou un comportement fusionnel. La solitude devient très difficile à vivre.
La blessure d’humiliation entraîne parfois une forte tendance à se dévaloriser, à se juger sévèrement, ou à ressentir de la honte sans raison apparente. Il peut y avoir une difficulté à affirmer ses besoins ou à se sentir digne de recevoir.
La blessure de trahison peut conduire à des difficultés à faire confiance, à vouloir tout contrôler, ou à avoir peur de se montrer vulnérable. Il y a souvent une crainte d’être déçu·e, manipulé·e ou abandonné·e si l’on relâche sa vigilance.
La blessure d’injustice est souvent associée à une rigidité, une exigence élevée envers soi-même et/ou les autres, un besoin de perfection. Elle peut générer une colère contenue, une hypersensibilité aux critiques ou à ce qui est perçu comme un manque d’équité.
Pourquoi comprendre mentalement ne suffit pas ?
Il arrive fréquemment que des personnes viennent en thérapie en disant : « Je sais pourquoi je réagis comme ça, je connais l’origine, mais je n’arrive pas à changer. »
Comprendre intellectuellement ses blessures est un premier pas essentiel, mais pas toujours suffisant. Pourquoi ? Parce que les blessures émotionnelles sont inscrites dans le corps, dans notre système nerveux, dans nos schémas neuronaux.
Alors comment aller plus loin ? En explorant ces blessures dans l’espace sécurisé de la thérapie, en leur permettant d’être reconnues, ressenties, traversées — et, peu à peu, intégrées.
En quoi la thérapie peut aider ?

La thérapie peut jouer un rôle essentiel pour :
- Identifier les schémas répétitifs qui se rejouent sans cesse.
- Accueillir les émotions refoulées : colère, tristesse, peur… souvent tues ou interdites dans l’enfance.
- Donner du sens à ce qui a été vécu, sans minimiser ni dramatiser.
- Réparer l’estime de soi, redonner de la valeur à qui l’on est profondément.
- Retrouver une liberté intérieure, sortir du pilote automatique, et faire des choix plus conscients et alignés.
Apaiser ses blessures émotionnelles ne signifie pas effacer le passé, ni faire comme si rien ne s’était passé.
Cela signifie changer la place que ce passé occupe dans notre vie actuelle : passer d’un vécu qui nous pilote en silence à une histoire que l’on peut regarder en face, comprendre, et intégrer.
C’est un travail qui demande du temps, de la patience, et de la bienveillance envers soi-même. Mais c’est aussi un chemin profondément libérateur.
Quel soulagement de ne plus réagir par automatisme, de ne plus se laisser submerger par des émotions que nous ne comprenons pas.
Quel bonheur que de réussir, enfin, à poser ses limites sans culpabilité, à exprimer ses besoins clairement, à se sentir légitime, à sa juste place, là où l’on s’est longtemps cru “trop” ou “pas assez”.
Il ne s’agit pas de devenir quelqu’un d’autre, mais d’être pleinement soi — une version plus vraie, plus alignée, plus libre de nous-même.
Conclusion
Certaines de nos difficultés d’adultes trouvent leurs racines dans le vécu de notre enfance. Il ne s’agit pas de chercher des coupables, ni de s’enfermer dans le passé, mais plutôt de reconnaître ce qui a été blessé — pour pouvoir enfin en prendre soin.
Un accompagnement thérapeutique peut vous aider à retrouver une relation plus apaisée avec vous-même, à vous réconcilier avec votre histoire et à oser être pleinement vous-même.
Je suis à votre écoute.
Je vous souhaite une agréable journée !